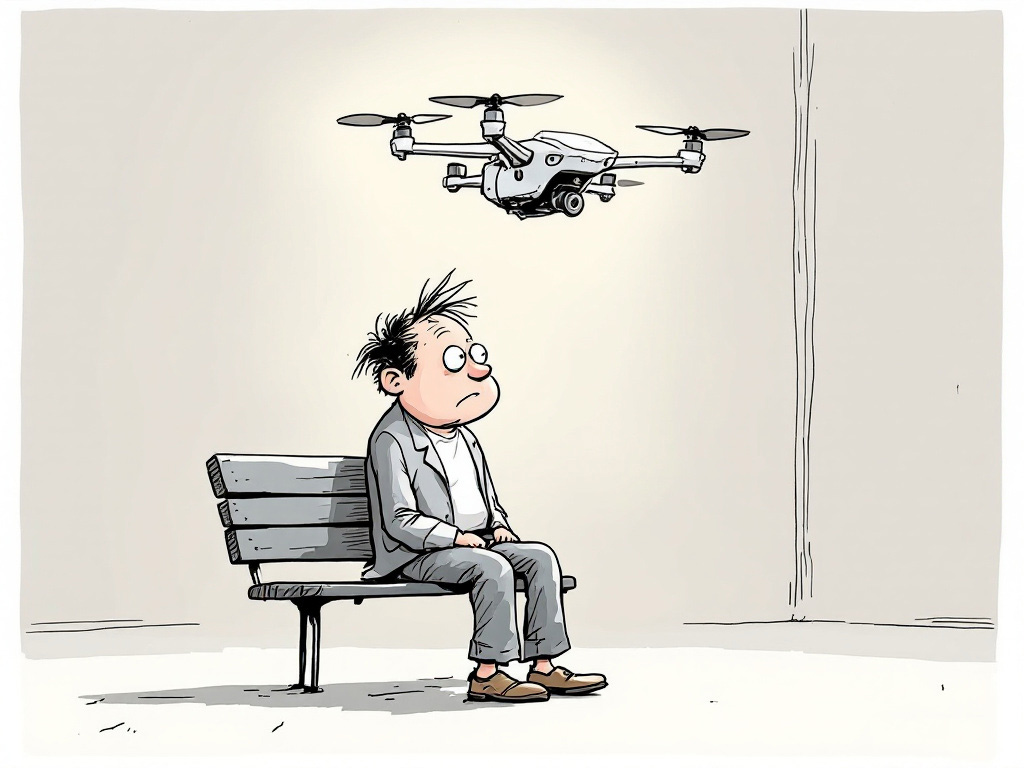Jeudi 02 octobre, les forces de l’ordre ont porté une fois de plus atteinte à la mission d’observation de l’ORLIB. L’Observatoire constate une augmentation récente des entraves aux observations de la part des forces de police à Rennes.
L’Observatoire Rennais des LIBertés publiques (ORLIB) est un collectif d’associations et de syndicats dont la mission est d’observer et de documenter les pratiques policières. Une équipe était présente à Rennes pour observer le maintien de l’ordre dans le cadre d’une manifestation le jeudi 2 octobre 2025 à 18h.
À 20h25, les observateur·ices accèdent rue Gurvand pour observer des contrôles et arrestations. En moins d’une minute, alors que l’équipe est à plus de 10 m de l’intervention, 5 policiers accourent vers elle et “l’invitent à quitter les lieux”, arguant du fait qu’elle se trouve “dans le périmètre d’intervention de la police nationale”. Alors que l’équipe fait valoir ses droits, les unités de police la font reculer sur l’entièreté de la rue, rendant impossible l’observation des interpellations. Cette entrave au droit d’observer est accompagnée d’usage de la force sur 2 membres de l’équipe, contraints physiquement de reculer alors qu’iels obtempèrent, et d’une menace de contrôle d’identité abusif :
“Est-ce qu’on a le droit de faire un contrôle d’identité puisque vous nous filmer ?“
Le 10 septembre, d’autres policiers avaient déjà procédé à un contrôle d’identité non justifié d’une équipe alors qu’elle venait de mettre fin à son observation.
Ces entraves ne sont pas des cas isolés. L’ORLIB fait face à de nombreuses obstructions et intimidations répétées dans le cadre de ses missions : captation d’images des observateur·ices avec des téléphones personnels, remarques outrancières, interactions menaçantes, restriction de déplacements… Ces pressions psychologiques de la part des forces de l’ordre ont pour objectif de dissuader les équipes de réaliser leurs missions. Ces faits ont déjà été exposés dans le dernier rapport annuel de l’ORLIB, mais tendent à se systématiser depuis le début du mois de septembre.
Ces entraves contreviennent au statut d’observateur·ice défini par le comité des droits de l’homme de l’ONU dans son observation n°37 : « il ne peut pas leur être interdit d’exercer [leur] fonction [d’observation] ni leur être imposé de limites à l’exercice de ces fonctions, y compris en ce qui concerne la surveillance des actions des forces de l’ordre« . Ils ne peuvent pas non plus être l’objet de représailles ou d’harcèlement de la part des forces de l’ordre. Ces droits subsistent lors d’une manifestation déclarée illégale.
De plus, le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juin 2021, a reconnu que les observateur·ices disposent des mêmes droits que les journalistes en manifestation. Ils peuvent donc se maintenir sur les lieux d’une manifestation même après l’ordre de dispersion.
Enfin, la circulaire du 23 décembre 2008 précise que les forces de l’ordre ne peuvent s’opposer à ce que leur action soit filmée.
L’ORLIB demande à la préfecture de faire cesser ces entraves aux observations.